Cette mesure de l’expansion a longtemps été estimée entre 50 et 100 km/s/Mpc et semblait pourtant converger...
Le désaccord entre astronomes sur le taux d’expansion de l’Univers se creuse un peu plus
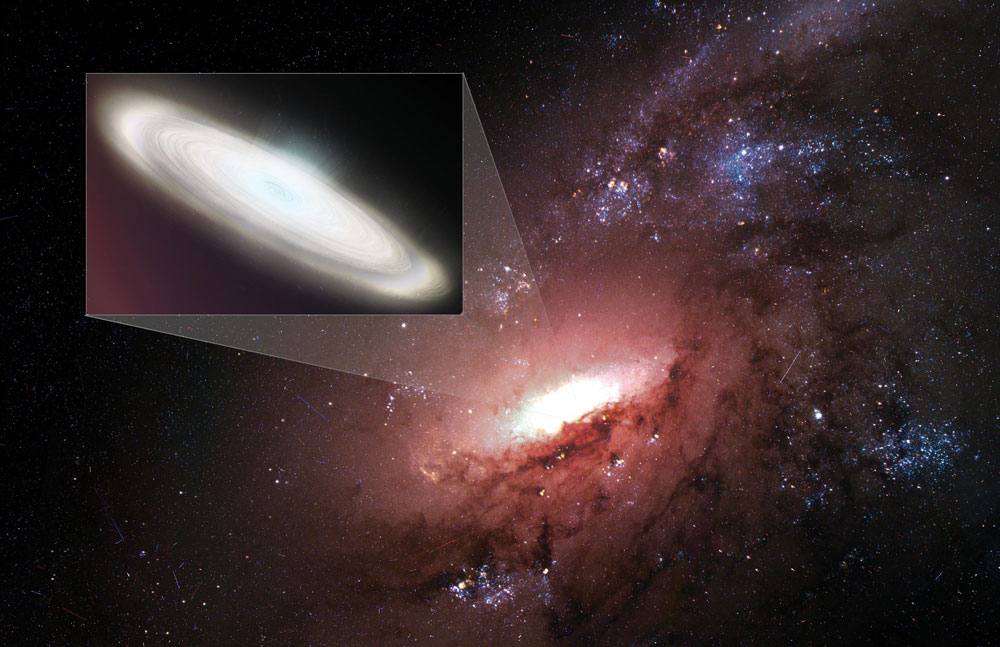
Cette mesure de l’expansion a longtemps été estimée entre 50 et 100 km/s/Mpc et semblait pourtant converger...






